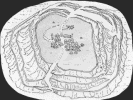 | | Les villes Celtiques |
| Nom antique: | Turiazu / Turiasso |
| Nom actuel: | Tarazona |
| Ville: | Tarazona |
| Localisation: | Province de Saragosse, Espagne |
| Peuple: | Lusones, Turiassonenses |
| Etymologie: | Le domaine de Tūriassos / Tūriassis |
|
|
 Turiazu / Turiasso - Ville des Lusones, elle se situait dans le nord de la Celtibérie, puis de la province romaine d'Hispanie citérieure / Tarraconaise, dans la juridiction de Caesaraugusta. La ville hispano-romaine correspond à l'actuelle Tarazona (province de Saragosse), tandis que l'emplacement de l'agglomération pré-romaine est discuté pour le moment (Gozalbes Fernández de Palencia, 2009). Le nom de cette ville fut mentionné indirectement par Pline, sous la forme du gentilé Turiassonenses (Histoire naturelle, III, 24). Elle apparaît ensuite sous la forme Turiassonem dans un autre passage de la même oeuvre (Histoire naturelle, XXXIV, 144). Par la suite, la ville apparut sous la forme Τουριασσώ dans la Géographie de Ptolémée (II, 6, 57) et Turiassone dans l'Itinéraire d'Antonin (442, 4 ; 443, 3). Les sources épigraphiques sont assez nombreuses, puisque cette localité apparaît sous la forme adjectivale Turiazu / Turiasso - Ville des Lusones, elle se situait dans le nord de la Celtibérie, puis de la province romaine d'Hispanie citérieure / Tarraconaise, dans la juridiction de Caesaraugusta. La ville hispano-romaine correspond à l'actuelle Tarazona (province de Saragosse), tandis que l'emplacement de l'agglomération pré-romaine est discuté pour le moment (Gozalbes Fernández de Palencia, 2009). Le nom de cette ville fut mentionné indirectement par Pline, sous la forme du gentilé Turiassonenses (Histoire naturelle, III, 24). Elle apparaît ensuite sous la forme Turiassonem dans un autre passage de la même oeuvre (Histoire naturelle, XXXIV, 144). Par la suite, la ville apparut sous la forme Τουριασσώ dans la Géographie de Ptolémée (II, 6, 57) et Turiassone dans l'Itinéraire d'Antonin (442, 4 ; 443, 3). Les sources épigraphiques sont assez nombreuses, puisque cette localité apparaît sous la forme adjectivale      / /  (Turiazika) sur la tessère d'hospitalité de Turiazu (Jordán Cólera, 2004) et TVRIASICA sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá (MLH IV [K.27.1]). En outre, on trouve T[V]RIAS[S]O/NINSIS sur la tessère d'hospitalité de Paredes de Nava (HEp 1999, 478 ; AE 1999, 922), TVRIASSONE(N)SIS sur une inscription de Bordeaux (CIL 13, 586) et TVRIASIONE sur la borne miliaire de Muro de Ágreda (CIL 17-01, 224 ; AE 1927, 162). Enfin, de nombreuses émissions monétaires mentionnent la ville sous les formes (Turiazika) sur la tessère d'hospitalité de Turiazu (Jordán Cólera, 2004) et TVRIASICA sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá (MLH IV [K.27.1]). En outre, on trouve T[V]RIAS[S]O/NINSIS sur la tessère d'hospitalité de Paredes de Nava (HEp 1999, 478 ; AE 1999, 922), TVRIASSONE(N)SIS sur une inscription de Bordeaux (CIL 13, 586) et TVRIASIONE sur la borne miliaire de Muro de Ágreda (CIL 17-01, 224 ; AE 1927, 162). Enfin, de nombreuses émissions monétaires mentionnent la ville sous les formes       et TVRIASO (Gozalbes Fernández de Palencia, 2004 ; 2009). Considérant ces différentes attestations, on considère que le nom celtibère de la ville était Turiazu, tandis que les orthographes Turiaso et Turiasso sont communément acceptées pour désigner la ville hispano-romaine. L'origine de ce toponyme est discutée. Bien que l'analyse proposée par W. F. von Humboldt (1821) soit fort ancienne, elle est encore fréquemment reprise. Elle repose sur une certaine proximité phonétique de ce toponyme avec le basque iturria- (en supposant la chute du "i" initial), qui signifie "source / fontaine" (1), et qui serait associé ici au suffixe -so, qui exprimerait l'idée de bonté. Ainsi, suivant ce point de vue, il conviendrait de traduire le composé *(i)turria-so par "bonne source / fontaine", ou par "abondance de sources / fontaines". Selon F. Villar (1995), les formes adjectivales du toponyme rencontrées sur la tessère d'hospitalité de Turiazu et sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá laissent entrevoir que le toponyme aurait pu être originellement *Turias. Suivant cette hypothèse, Turiazu serait une adaptation celtibérique d'un toponyme plus ancien, lequel se rapporterait un un hydronyme, *Turis. Dans le même ordre d'idée, M. Beltrán Lloris, (2004a), en se rapportant au travail de J. Diez Asensio (1992), rapproche ce toponyme d'un radical sourd-sonore alternant *tur- / dur- à valeur hydronymique, que les linguistes attribuent selon les cas à la langue ligure, au celtique ou encore à l'illyrien. X. Delamarre (2012) quant à lui voit en Turiazu / Turiasso (< Tūriassū) un toponyme celtique à caractère théonymique, avec une dérivation en nasale. Ainsi, il traduit ce nom par "le domaine (du dieu) Tūriassos / Tūriassis". et TVRIASO (Gozalbes Fernández de Palencia, 2004 ; 2009). Considérant ces différentes attestations, on considère que le nom celtibère de la ville était Turiazu, tandis que les orthographes Turiaso et Turiasso sont communément acceptées pour désigner la ville hispano-romaine. L'origine de ce toponyme est discutée. Bien que l'analyse proposée par W. F. von Humboldt (1821) soit fort ancienne, elle est encore fréquemment reprise. Elle repose sur une certaine proximité phonétique de ce toponyme avec le basque iturria- (en supposant la chute du "i" initial), qui signifie "source / fontaine" (1), et qui serait associé ici au suffixe -so, qui exprimerait l'idée de bonté. Ainsi, suivant ce point de vue, il conviendrait de traduire le composé *(i)turria-so par "bonne source / fontaine", ou par "abondance de sources / fontaines". Selon F. Villar (1995), les formes adjectivales du toponyme rencontrées sur la tessère d'hospitalité de Turiazu et sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá laissent entrevoir que le toponyme aurait pu être originellement *Turias. Suivant cette hypothèse, Turiazu serait une adaptation celtibérique d'un toponyme plus ancien, lequel se rapporterait un un hydronyme, *Turis. Dans le même ordre d'idée, M. Beltrán Lloris, (2004a), en se rapportant au travail de J. Diez Asensio (1992), rapproche ce toponyme d'un radical sourd-sonore alternant *tur- / dur- à valeur hydronymique, que les linguistes attribuent selon les cas à la langue ligure, au celtique ou encore à l'illyrien. X. Delamarre (2012) quant à lui voit en Turiazu / Turiasso (< Tūriassū) un toponyme celtique à caractère théonymique, avec une dérivation en nasale. Ainsi, il traduit ce nom par "le domaine (du dieu) Tūriassos / Tūriassis".
 Compte-tenu de la rareté des traces d'occupation pré-romaine à Tarazona, il a longtemps semblé évident que la ville celtibère de Turiazu devait se trouver ailleurs, et qu'il s'agissait donc de l'un des nombreux cas de déplacement d'agglomération à l'époque romaine. Plusieurs sites pré-romains de la région ont donc été suspectés avoir été la ville indigène, en premier lieu le riche oppidum de La Oruña (Vera de Moncayo, province de Saragosse) (2), situé à seulement 10 kilomètres de Tarazona (García Serrano, 2003-2004 ; Gozalbes Fernández de Palencia, 2009). Outre l'abondance de matériel indiscutablement celtibère, la possibilité d'identifier l'oppidum de La Oruña comme étant l'antique Turiazu a été renforcée par la découverte des vestiges d'importants fourneaux metallurgiques et des fonderies de fer, qui produisaient un acier doux de qualité (Hernández Vera & Murillo Ramos, 1985). En effet, Pline soulignait que cette ville était réputée pour sa production d'acier de qualité (Histoire naturelle, XXXIV, 144), or rien de comparable n'a été identifié au niveau de la ville hispano-romaine, ce qui amène à penser qu'il utilisait des informations qui n'étaient plus d'actualité de son temps. Cette idée de situer la ville pré-romaine ailleurs qu'à Tarazona n'a cependant jamais fait l'unanimité, puisque dés 1981, sur la foi des rares vestiges découverts, J. L. Corral Lafuente & P. J. Rico Lacasa envisageaient l'existence d'une petite agglomération de 3,5 ha, pour une population de 700 à 800 habitants, au niveau du quartier de El Cinto, le centre historique de Tarazona, Ce quartier est situé sur une éminence qui occupait effectivement une position stratégique le long d'un axe naturel matérialisé par la vallée du rio Queiles, reliant la Meseta ibérique à la vallée de l'Èbre. Les nombreuses fouilles récentes réalisées dans différents secteurs de Tarazona (mais principalement à El Cinto), révèlent de plus en plus communément des niveaux assurément pré-romains, potentiellement du IIe s. av. J.-C., ce qui pourrait accréditer l'idée d'y localiser Turiazu. À ce jour, ces découvertes sont encore insuffisantes pour déterminer la nature précise des traces d'habitats obersées et démontrer l'existence d'une ville pré-romaine, mais sont assez convaincantes pour ne pas rejeter définitivement cette hypothèse (Beltrán Lloris, 2004a ; García Serrano, 2003-2004 ; 2017). Compte-tenu de la rareté des traces d'occupation pré-romaine à Tarazona, il a longtemps semblé évident que la ville celtibère de Turiazu devait se trouver ailleurs, et qu'il s'agissait donc de l'un des nombreux cas de déplacement d'agglomération à l'époque romaine. Plusieurs sites pré-romains de la région ont donc été suspectés avoir été la ville indigène, en premier lieu le riche oppidum de La Oruña (Vera de Moncayo, province de Saragosse) (2), situé à seulement 10 kilomètres de Tarazona (García Serrano, 2003-2004 ; Gozalbes Fernández de Palencia, 2009). Outre l'abondance de matériel indiscutablement celtibère, la possibilité d'identifier l'oppidum de La Oruña comme étant l'antique Turiazu a été renforcée par la découverte des vestiges d'importants fourneaux metallurgiques et des fonderies de fer, qui produisaient un acier doux de qualité (Hernández Vera & Murillo Ramos, 1985). En effet, Pline soulignait que cette ville était réputée pour sa production d'acier de qualité (Histoire naturelle, XXXIV, 144), or rien de comparable n'a été identifié au niveau de la ville hispano-romaine, ce qui amène à penser qu'il utilisait des informations qui n'étaient plus d'actualité de son temps. Cette idée de situer la ville pré-romaine ailleurs qu'à Tarazona n'a cependant jamais fait l'unanimité, puisque dés 1981, sur la foi des rares vestiges découverts, J. L. Corral Lafuente & P. J. Rico Lacasa envisageaient l'existence d'une petite agglomération de 3,5 ha, pour une population de 700 à 800 habitants, au niveau du quartier de El Cinto, le centre historique de Tarazona, Ce quartier est situé sur une éminence qui occupait effectivement une position stratégique le long d'un axe naturel matérialisé par la vallée du rio Queiles, reliant la Meseta ibérique à la vallée de l'Èbre. Les nombreuses fouilles récentes réalisées dans différents secteurs de Tarazona (mais principalement à El Cinto), révèlent de plus en plus communément des niveaux assurément pré-romains, potentiellement du IIe s. av. J.-C., ce qui pourrait accréditer l'idée d'y localiser Turiazu. À ce jour, ces découvertes sont encore insuffisantes pour déterminer la nature précise des traces d'habitats obersées et démontrer l'existence d'une ville pré-romaine, mais sont assez convaincantes pour ne pas rejeter définitivement cette hypothèse (Beltrán Lloris, 2004a ; García Serrano, 2003-2004 ; 2017).
 La ville hispano-romaine de Turiasso recouvre ces niveaux antérieurs, mais son extension dépassait la seule éminence d'El Cinto, puisque de vestiges ont été décelés sur toute la rive gauche du rio Queiles (et dans une bien moindre mesure sur la rive droite). Selon les quelques estimations disponibles, entre le Ier et le IIe s. ap. J.-C., elle couvrait une superficie de 10 à 30 ha, et possédait une population de près de 3000 habitants (Corral Lafuente & Rico Lacasa, 1981). Cette petite agglomération tirait sans doute une part importante de sa prospérité de sa position de carrefour entre l'axe protohistorique précédemment mentionné et plusieurs voies romaines. L'une d'entre elles menait à Asturica Augusta (Astorga), tandis que deux autres permettaient de gagner Caesaraugusta (Saragosse). Turiasso était visiblement la capitale d'une petite communauté celtibère antérieurement à la conquête. Elle conserva visiblement ce rôle par la suite et fut le siège d'un municipe hispano-romain des Turiasonenses dés la fin du Ier s. av. J.-C. (3). Même si l'emplacement de la ville ne fait aucun doute, la connaissance de son urbanisme demeure parcellaire en raison des importants remaniements médiévaux et du fait que la ville contemporaine, avec les nombreuses usines qui y ont été installées au XXe s., recouvre les vestiges antiques. Ainsi, les campagnes de fouilles effectuées à Tarazona n'ont été que ponctuelles et ne permettent que de se faire une idée assez imprécise de l'aspect de la Turiasso hispano-romaine (García Serrano, 2017). Tout juste aton pu identifier quelques rares témoins de la parure monumentale de la ville, et notamment un nymphée lié à un culte des eaux, qui fut actif entre la fin du Ier s. et la fin du IIIe s. ap. J.-C. (Beltrán Lloris et al., 2004 ; Beltrán Lloris & Paz Peralta, 2004). La ville hispano-romaine de Turiasso recouvre ces niveaux antérieurs, mais son extension dépassait la seule éminence d'El Cinto, puisque de vestiges ont été décelés sur toute la rive gauche du rio Queiles (et dans une bien moindre mesure sur la rive droite). Selon les quelques estimations disponibles, entre le Ier et le IIe s. ap. J.-C., elle couvrait une superficie de 10 à 30 ha, et possédait une population de près de 3000 habitants (Corral Lafuente & Rico Lacasa, 1981). Cette petite agglomération tirait sans doute une part importante de sa prospérité de sa position de carrefour entre l'axe protohistorique précédemment mentionné et plusieurs voies romaines. L'une d'entre elles menait à Asturica Augusta (Astorga), tandis que deux autres permettaient de gagner Caesaraugusta (Saragosse). Turiasso était visiblement la capitale d'une petite communauté celtibère antérieurement à la conquête. Elle conserva visiblement ce rôle par la suite et fut le siège d'un municipe hispano-romain des Turiasonenses dés la fin du Ier s. av. J.-C. (3). Même si l'emplacement de la ville ne fait aucun doute, la connaissance de son urbanisme demeure parcellaire en raison des importants remaniements médiévaux et du fait que la ville contemporaine, avec les nombreuses usines qui y ont été installées au XXe s., recouvre les vestiges antiques. Ainsi, les campagnes de fouilles effectuées à Tarazona n'ont été que ponctuelles et ne permettent que de se faire une idée assez imprécise de l'aspect de la Turiasso hispano-romaine (García Serrano, 2017). Tout juste aton pu identifier quelques rares témoins de la parure monumentale de la ville, et notamment un nymphée lié à un culte des eaux, qui fut actif entre la fin du Ier s. et la fin du IIIe s. ap. J.-C. (Beltrán Lloris et al., 2004 ; Beltrán Lloris & Paz Peralta, 2004).
 La ville perdit de sa superbe dés la fin du IIIe s., sans doute suite aux invasions des années 260. De nombreux batiments furent alors ruinés et la superficie de la ville se réduisit notablement. Elle conserva cependant une certaine importance puisqu'elle devint le siège d'un diocèse, dont le plus ancien évêque répertorié fut Leo (Léon), au Ve s. La ville perdit de sa superbe dés la fin du IIIe s., sans doute suite aux invasions des années 260. De nombreux batiments furent alors ruinés et la superficie de la ville se réduisit notablement. Elle conserva cependant une certaine importance puisqu'elle devint le siège d'un diocèse, dont le plus ancien évêque répertorié fut Leo (Léon), au Ve s.
Notes
(1) Cette ville se trouvait en effet à l'extrémité septentrionale de la Celtibérie, dans le voisinage proche du domaine hypothétiquement peuplé par les populations proto-basques.
(2) Ce même site est également suspecté avoir été l'antique Complega, dont on sait qu'elle se trouvait dans ce secteur (García Serrano, 2003-2004).
(3) L'érection en municipe de cette petite cité à une date haute est conjecturée à partir de ses émissions monétaires.
Sources littéraires anciennes
| Pline, Histoire naturelle, III, 24 : "Caesaraugusta, colonie jouissant de l'immunité, baignée par l'HIberus, occupant l'emplacement d'une ville appelée Salduba, appartient à l'Edétanie. Elle a dans son ressort 55 peuples : parmi ceux ayant le droit romain sont les Bélitans ; les Celsenses, autrefois colonie ; les Calaguritans, surnommés Nasiques ; les Ilerdenses de la nation des Surdaons, auprès desquels est le fleuve Sicoris ; les Oscenses de la Suessetanie ; les Turiassonenses ; à droit latin ancien sont les Cascantenses ; les Ergavicenses ; les Graccuritans ; les Léonicenses ; les Osicerdenses ; les alliés, les Tarragenses ; parmi les tributaires sont les Arcobricenses ; les Andologenses ; les Arocélitans ; les Bursaonenses ; les Calaguritans, surnommés Fibularenses ; les Conplutenses ; les Carenses ; les Cincienses ; les Cortonenses ; les Damanitans ; les Ispallenses ; les Ilursenses ; les Ilurbéritans ; les Iacétans ; les Libienses ; les Pompelonenses ; les Segienses."
|
| Pline, Histoire naturelle, XXXIV, 144 : "Mais la différence la plus grande provient de l'eau dans laquelle on plonge le fer incandescent : cette eau, dont la bonté varie suivant les lieux, a rendu fameuses pour la fabrication du fer certaines localités, telles que Bilbilis et Turiasso en Hispanie, et Comum en ltalie, bien que ces endroits n'aient pas de mines de fer. Mais de tous les fers la palme est à celui de la Sérique, qui nous l'envoie avec ses étoffes et ses pelleteries."
|
Sources épigraphiques
Bordeaux (CIL 13, 586)
[SIR]ONAE(?) M(ARCVS) SVLPICIVS PRIMVLVS // TVRIASSONE(N)SIS SEVIRAL(IS) D(E) S(VA) P(ECVNIA) F(ACIENDVM) C(VRAVIT) // SVLPICIVS SACVRO F(ILIVS) // SVLPICIA CENSORINA F(ILIA) // SVLPICIA PHOEBE L(IBERTA)
|
"À Sirona (?). Marcus Sulpicius Primulus, de Turiasso, ancien sévir, a pris soin de faire (ce monument), à ses frais"
"Sulpicius Sacuro, son fils"
"Sulpicia Censorina, sa fille"
"Sulpicia Phoebe, son affranchie."
Borne miliaire de Muro de Ágreda (Ólvega) (CIL 17-01, 224 ; AE 1927, 162)
TI(BERIVS) CAESAR DIVI AVG(VSTI) F(ILIVS) / DIVI IVLI N(EPOS) AVGVSTVS / PONTIFEX MAX(IMVS) TRIB(VNICIA) / POT(ESTATE) XXXV IMP(ERATOR) VIII[I] / CO(N)S(VL) V / TVRIAS(S)IONE / M(ILIA) (!) XXII
|
"Tiberius César Auguste, fils du divin Auguste, petit-fils du divin Iulius, grand pontif, 35 fois revêtu de la puissance tribunicienne (1), 8 fois salué impérator, 5 fois consul (a fait). Depuis Turiasso, 22 mille pas."
(1) Tibère fut détenteur de sa 35e puissance tribunicienne entre le 26 juin 33 et le 25 juin 34 ap. J.-C.
Tessère d'hospitalité de Monte Cildá (Olleros de Pisuerga) (MLH IV [K.27.1])
TVRIASICA / CAR
|
"Hospitalité de Turias(o)."
Tessère d'hospitalité de Paredes de Nava (HEp 1999, 478 ; AE 1999, 922)
M(ARCVS) TITIVS FRONTO T[V]RIAS[S]O/N<E=I>NSIS SIBI LIBERIS POSTERIS/QVE T<E=I>SSARAM HOSPITALE[M] / FECIT CVM POPVLO INTERCA/TIENSE EODEM IVRE EADEM / LEGE QVA INTERCATIENSES
|
"Marcus Titius Fronto, de Turiasso, pour lui-même, ses enfants et leurs descendants, a fait une tessère d'hospitalité avec le peuples des Intercatienses, suivant le même droit et la même loi que les Intercatienses."
Tessère d'hospitalité de Turiazu (Jordán Cólera, 2004)
     / /   / /    
|
"Tessère d'hospitalité de Turiaz(u)."
|
Sources:
M. Beltrán Lloris, (2004a) - "I. Turiasu. Antecedentes indígenas", in : M. Beltrán Lloris & J. Á. Paz Peralta (coord.), Las aguas sagradas del 'Municipium Turiaso', excavaciones en el patio del colegio Joaquín Costa (antiguo allué Salvador). Tarazona (Zaragoza), Caesarobriga, n°76, Institución "Fernando el Católico", Sarragosse, pp.19-21
M. Beltrán Lloris, (2004b) - "II. Turiaso. La ciudad romana", in : M. Beltrán Lloris & J. Á. Paz Peralta (coord.), Las aguas sagradas del 'Municipium Turiaso', excavaciones en el patio del colegio Joaquín Costa (antiguo allué Salvador). Tarazona (Zaragoza), Caesarobriga, n°76, Institución "Fernando el Católico", Sarragosse, pp.19-21
M. Beltrán Lloris et al., (2004) - "V. Las aguas sagradas", in : M. Beltrán Lloris & J. Á. Paz Peralta (coord.), Las aguas sagradas del 'Municipium Turiaso', excavaciones en el patio del colegio Joaquín Costa (antiguo allué Salvador). Tarazona (Zaragoza), Caesarobriga, n°76, Institución "Fernando el Católico", Sarragosse, pp.296-321
M. Beltrán Lloris & J. Á. Paz Peralta, (2004) - "VI. Desarrollo histórico del culto a las aguas en Turiaso", in : M. Beltrán Lloris & J. Á. Paz Peralta (coord.), Las aguas sagradas del 'Municipium Turiaso', excavaciones en el patio del colegio Joaquín Costa (antiguo allué Salvador). Tarazona (Zaragoza), Caesarobriga, n°76, Institución "Fernando el Católico", Sarragosse, pp.323-343
J. L. Corral Lafuente & P. J. Rico Lacasa, (1981) - "Evolución histórica del urbanismo en Tarazona:aproximación a su estudio", Cuadernos de Aragón, n°14-15, pp.199-222
X. Delamarre, (2012) - Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne, Errance, Paris, 384p.
J. Díez Asensio, (1992) - "Hidronimia y oronimia de base prerromana al sur del Duero en las fuentes antiguas", Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua (Valladolid), n°16, pp.131-137
J. A. García Serrano, (2003-2004) - "Turiaso-Turiazu. ¿ Dónde está la ciudad celtibérica ?", TVRIASO, n°17, pp.119-133
J. A. García Serrano, (2017) - "Aproximación a la Turiaso imperial", in : C. García Benito et al., (coord.), Arqueología y Poblamiento en el valle del Queiles, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución "Fernando el Católico", Tarazona, pp.113-154
M. Gozalbes Fernández de Palencia, (2003-2004) - "Las monedas de Turiazu", TVRIASO, n°17, pp.135-154
M. Gozalbes Fernández de Palencia, (2009) - La ceca de Turiazu. Monedas celtibéricas en la Hispania republicana, Diputación de Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia, Serie de trabajos varios n°110, Valencia, 276p.
J. A. Hernández Vera & J. J. Murillo Ramos, (1985) - "Aproximación al estudio de la siderurgia celtibérica del Moncayo", Caesaraugusta, n°61-62, pp.177-190
C. Jordán Cólera, (2004) - "Chronica epigraphica celtiberica III", Palaeohispanica, vol. 4, pp.285-323
F. Villar, (1995) - Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana, Acta Salmanticensia, Estudios filológicos, 260, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 273p.
Julien Quiret pour l'Arbre Celtique
|
|


 Espace Découverte
Espace Découverte
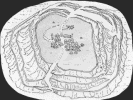
 Turiazu / Turiasso - Ville des Lusones, elle se situait dans le nord de la Celtibérie, puis de la province romaine d'Hispanie citérieure / Tarraconaise, dans la juridiction de Caesaraugusta. La ville hispano-romaine correspond à l'actuelle Tarazona (province de Saragosse), tandis que l'emplacement de l'agglomération pré-romaine est discuté pour le moment (Gozalbes Fernández de Palencia, 2009). Le nom de cette ville fut mentionné indirectement par
Turiazu / Turiasso - Ville des Lusones, elle se situait dans le nord de la Celtibérie, puis de la province romaine d'Hispanie citérieure / Tarraconaise, dans la juridiction de Caesaraugusta. La ville hispano-romaine correspond à l'actuelle Tarazona (province de Saragosse), tandis que l'emplacement de l'agglomération pré-romaine est discuté pour le moment (Gozalbes Fernández de Palencia, 2009). Le nom de cette ville fut mentionné indirectement par 



 /
/ (Turiazika) sur la tessère d'hospitalité de Turiazu (Jordán Cólera, 2004) et TVRIASICA sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá (MLH IV [K.27.1]). En outre, on trouve T[V]RIAS[S]O/NINSIS sur la tessère d'hospitalité de Paredes de Nava (HEp 1999, 478 ; AE 1999, 922), TVRIASSONE(N)SIS sur une inscription de Bordeaux (CIL 13, 586) et TVRIASIONE sur la borne miliaire de Muro de Ágreda (CIL 17-01, 224 ; AE 1927, 162). Enfin, de nombreuses émissions monétaires mentionnent la ville sous les formes
(Turiazika) sur la tessère d'hospitalité de Turiazu (Jordán Cólera, 2004) et TVRIASICA sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá (MLH IV [K.27.1]). En outre, on trouve T[V]RIAS[S]O/NINSIS sur la tessère d'hospitalité de Paredes de Nava (HEp 1999, 478 ; AE 1999, 922), TVRIASSONE(N)SIS sur une inscription de Bordeaux (CIL 13, 586) et TVRIASIONE sur la borne miliaire de Muro de Ágreda (CIL 17-01, 224 ; AE 1927, 162). Enfin, de nombreuses émissions monétaires mentionnent la ville sous les formes  et TVRIASO (Gozalbes Fernández de Palencia, 2004 ; 2009). Considérant ces différentes attestations, on considère que le nom celtibère de la ville était Turiazu, tandis que les orthographes Turiaso et Turiasso sont communément acceptées pour désigner la ville hispano-romaine. L'origine de ce toponyme est discutée. Bien que l'analyse proposée par W. F. von Humboldt (1821) soit fort ancienne, elle est encore fréquemment reprise. Elle repose sur une certaine proximité phonétique de ce toponyme avec le basque iturria- (en supposant la chute du "i" initial), qui signifie "source / fontaine" (1), et qui serait associé ici au suffixe -so, qui exprimerait l'idée de bonté. Ainsi, suivant ce point de vue, il conviendrait de traduire le composé *(i)turria-so par "bonne source / fontaine", ou par "abondance de sources / fontaines". Selon F. Villar (1995), les formes adjectivales du toponyme rencontrées sur la tessère d'hospitalité de Turiazu et sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá laissent entrevoir que le toponyme aurait pu être originellement *Turias. Suivant cette hypothèse, Turiazu serait une adaptation celtibérique d'un toponyme plus ancien, lequel se rapporterait un un hydronyme, *Turis. Dans le même ordre d'idée, M. Beltrán Lloris, (2004a), en se rapportant au travail de J. Diez Asensio (1992), rapproche ce toponyme d'un radical sourd-sonore alternant *tur- / dur- à valeur hydronymique, que les linguistes attribuent selon les cas à la langue ligure, au celtique ou encore à l'illyrien. X. Delamarre (2012) quant à lui voit en Turiazu / Turiasso (< Tūriassū) un toponyme celtique à caractère théonymique, avec une dérivation en nasale. Ainsi, il traduit ce nom par "le domaine (du dieu) Tūriassos / Tūriassis".
et TVRIASO (Gozalbes Fernández de Palencia, 2004 ; 2009). Considérant ces différentes attestations, on considère que le nom celtibère de la ville était Turiazu, tandis que les orthographes Turiaso et Turiasso sont communément acceptées pour désigner la ville hispano-romaine. L'origine de ce toponyme est discutée. Bien que l'analyse proposée par W. F. von Humboldt (1821) soit fort ancienne, elle est encore fréquemment reprise. Elle repose sur une certaine proximité phonétique de ce toponyme avec le basque iturria- (en supposant la chute du "i" initial), qui signifie "source / fontaine" (1), et qui serait associé ici au suffixe -so, qui exprimerait l'idée de bonté. Ainsi, suivant ce point de vue, il conviendrait de traduire le composé *(i)turria-so par "bonne source / fontaine", ou par "abondance de sources / fontaines". Selon F. Villar (1995), les formes adjectivales du toponyme rencontrées sur la tessère d'hospitalité de Turiazu et sur la tessère d'hospitalité de Monte Cildá laissent entrevoir que le toponyme aurait pu être originellement *Turias. Suivant cette hypothèse, Turiazu serait une adaptation celtibérique d'un toponyme plus ancien, lequel se rapporterait un un hydronyme, *Turis. Dans le même ordre d'idée, M. Beltrán Lloris, (2004a), en se rapportant au travail de J. Diez Asensio (1992), rapproche ce toponyme d'un radical sourd-sonore alternant *tur- / dur- à valeur hydronymique, que les linguistes attribuent selon les cas à la langue ligure, au celtique ou encore à l'illyrien. X. Delamarre (2012) quant à lui voit en Turiazu / Turiasso (< Tūriassū) un toponyme celtique à caractère théonymique, avec une dérivation en nasale. Ainsi, il traduit ce nom par "le domaine (du dieu) Tūriassos / Tūriassis".


 [ villes celtiques d'Hispanie & hispano-romaines [de Abobriga à Augustobriga] ]
[ villes celtiques d'Hispanie & hispano-romaines [de Abobriga à Augustobriga] ] [ La Géographie de Ptolémée ]
[ La Géographie de Ptolémée ]
