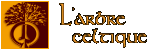[2,102] Pour ce qui est de l'argent, on dit que, lors des triomphes, furent portﺣ۸s en procession 60.500 talents, ainsi que 2.822 couronnes d'or pesant 20.414 livres.
* Pour info, vingt talents ﺣ۸tait ce que valait la ranﺣ۶on de Cﺣ۸sar aprﺣ۷s qu'il fut capturﺣ۸ et ranﺣ۶onnﺣ۸ dans sa jeunesse par des pirates :
[II] (1) Ces pirates lui demandﺣ۷rent vingt talents pour sa ranﺣ۶on ; il se moqua d'eux de ne pas savoir quel ﺣ۸tait leur prisonnier, et il leur en promit cinquante.
Pour revenir sur Alﺣ۸sia :
Adcanaunos a ﺣ۸crit:Re-Mmmh... Navrﺣ۸ d'insister, mais s'il est question de boucliers (arvernes !) dorﺣ۸s ou argentﺣ۸s, la phrase de Plutarque ﺣ۸tablit prﺣ۸cisﺣ۸ment la distinction avec la vaisselle et les "pavillons gaulois". La juxtaposition des vaisselles et des carnyx, dﺣ۸sormais bien attestﺣ۸s pour cette ﺣ۸poque par les dﺣ۸pﺣﺑts de Tintignac, suggﺣ۷re a contrario qu'elle ﺣ۸tait en bronze. Pour le reste, ces dﺣ۸tails correspondent de toute ﺣ۸vidence ﺣ une enjolivure ﺣ valeur topique. Sa "source" principale, ﺣ savoir le texte de Cﺣ۸sar (VII, 45-50), n'en fait pas mention.
Vu la violence des combats ﺣ Alﺣ۸sia, certainement que nﻗimporte quel objet disponible dans la nature ou tout ce qui traﺣ؟ne ﺣ portﺣ۸e de la main (pierre, branche dﻗarbre, gobelets, coupes, service de table, chaudrons, piﺣ۷ces de monnaies, lardoire, loucheﻗ۵) pouvait servir, faute de mieux, aux belligﺣ۸rants de projectiles ou dﻗaccessoires ﺣ balancer ou pour cogner.
Mais je ne vois pas le rapport ﺣ۸voquﺣ۸ de la ﺡ، vaisselle ﺡﭨ de Plutarque avec celle de Tintignac (chaudron + armes + instruments musicaux de guerre consacrﺣ۸s) ?
e.