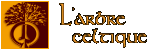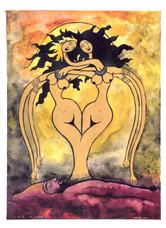Myth ou realitÃĐ??
|
Chiens de GuerreModÃĐrateurs: Pierre, Guillaume, Patrice
52 messages • Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Il y a aussi, des 'cwn annwn' ou les chiens de la chasse 'sauvage', qui paraÃŪtent dans le premiÃĻre livre de Mabinogion, quand Pryderi a 'volÃĐ' le cerf du roi de Annwn. . . .
Myth ou realitÃĐ?? Serch sy'n y Nerth y ddihuno y Ddraig gysglaid
Salut, merci pour l'info, mÊme datÃĐe, c'est quand mÊme plus proche que Jullian. Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ÎĢÎÎÎÎĨÎÎÎÎĢ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer à la bravoure."
Salut,
Ca m'est sorti de l'esprit, mais j'ai vu un article sur les chiens de chasse et de guerre soit chez les Russes, soit ches un peuple turc de SibÃĐrie occidentale, je ne sais plus, au Moyen Ãge. Il faudrait que j'essaie de retrouver ça... A+ Patrice Pi d'avri vaut fout' d'berbis
A lire donc, ce remarquable petit article avec dÃĐtail des piÃĻces de monnaie au renard ou loup (?), dÃĐpÃīt de crÃĒnes de canidÃĐs et de petits carnivoresâĶ : Saturnia tellus http://www.archeo.ens.fr/8546-6Buch/sem ... m_poux.pdf On retrouvera le prodigue Luern et ses variantes ÃĐcrites et phonÃĐtiques (Luernos, Luernios, LuÃĐrius, Louernos, LuvernosâĶ) et sa meute de chiens, gardiens oblige du char dâargent . Et tel pÃĻre, son fils Bituit (Bituitus, BituitosâĶ), pour qui, une armÃĐe romaine ne pourrait suffire à nourrir sa meute royale composÃĐe dâÃĐnormes dogues venus, semble-t'il, à grands frais de Belgique et de Bretagne :
A ce propos de la confiance portÃĐe aux meutes de chiens dans l'Empire romain, l'histoire de Massinisa ou Massinissa :
e.
Ce manquement à ma promesse - impitoyablement rappelÃĐe par ejds - me vaudra d'Être jetÃĐ en pÃĒture aux molosses du premier roitelet celtibÃĻre ! L'article en question n'ayant pas encore paru dans les collections de l'EFR, je prie les lecteurs de ce forum de ne pas le diffuser et de rester discrets quant à sa prÃĐsence sur le serveur de mon laboratoire... Et accessoirement, de faire preuve d'indulgence pour les coquilles qui n'ont pas encore ÃĐtÃĐ ÃĐpurÃĐes par le comitÃĐ de lecture... Site Internet : http://luern.free.fr
Du chien, du loup, du lynx, du renard âĶ et de Lug !
Pour remordre dans la symbolique celtique et la thÃĐmatique des carnivores domestiques ou sauvages, mais aussi dans lâÃĐtymologie des noms, quelques extraits repris du Dictionnaire des Symboles (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant - Editions Seghers, 1974) :
Voici l'histoire de la mort de Cuchulainn :
Un site sur le loup : http://www.loup.org/
Un site trÃĻs fÃĐlin sur le retour du lynx en Suisse : http://www.wild.unizh.ch/lynx/f/f_bi.htm
A signaler aussi sur le renard un extrait de :
e. DerniÃĻre ÃĐdition par ejds le Mar 14 FÃĐv, 2006 12:05, ÃĐditÃĐ 2 fois.
"L'article en question"
TrÃĻs intÃĐressant! Le dÃĐcalage d'environ 30° sur le mÃĐridien donne un azimut sur le nord de 60° pour la direction que regarde le cÃītÃĐ oriental du sanctuaire de Corent (et sa porte). Serait-il possible de prÃĐciser ces "environ 30°"? En 100 av. JC, c'est la direction vers le lever du soleil le 29 juillet (calendrier julien, hauteur de l'horizon 0°, il faut voir sur place quelle est la hauteur rÃĐelle de l'horizon dans cette direction). En 250 av. JC, c'est le 31 juillet. Difficile de ne pas voir un lien avec le calendrier celtique. "son tracÃĐ est dÃĐterminÃĐ par des visÃĐes et calculs astronomiques prÃĐcis". J'ai tendance à le penser et il faudrait davantage rÃĐflÃĐchir à cela et examiner sous cet aspect les plans des sanctuaires (mais certains archÃĐologues semblent fÃĒchÃĐs avec le sens de l'orientation, m'en est tÃĐmoin ma derniÃĻre rencontre, toute rÃĐcente, avec l'un d'entre eux). Et aussi, la diagonale n'est pas "alignÃĐe sur le nord terrestre", formulation à revoir. Bien cordialement, gg
Merci ejds, pour toutes ces rÃĐfÃĐrences historico-onomastiques. Elles prolongent les perspectives ouvertes par nos crÃĒnes de carnassiers, clouÃĐs de façon emblÃĐmatique sur la porte de l'un des principaux sanctuaires arvernes de l'avant-conquÊte ! A l'attention de GÃĐrard MÃĐrel : non, les archÃĐologues ne sont pas tous fÃĒchÃĐs avec les chiffres, la gÃĐographie ou l'astronomie. Ils ne sont, pour la plupart (c'est mon cas), pas compÃĐtents en la matiÃĻre ! Au reste, cette question a dÃĐjà fait l'objet d'un dÃĐbat sur un autre fil, plus en rapport avec le sujet : http://forum.arbre-celtique.com/viewtopic.php?p=26434#26434 Merci quand-mÊme pour toutes ces prÃĐcisions Site Internet : http://luern.free.fr
Un fil bien intÃĐressant d'ailleurs et toujours utile à relire.
GÃĐrard, je commence à comprendre tes recherches mais tu sembles axÃĐ sur un lever solaire "relatif" qui correspondrait à une forme de gÃĐomancie. Nous savons que les druides, du moins certains d'entre eux, ÃĐtaient fort versÃĐs en astronomie et mathÃĐmatiques et la question que je me pose : - Pourquoi pas des levers "absolus", et pas simplement solaires d'ailleurs, nous savons l'importance des levers hÃĐliaques des PlÃĐiades dÃĻs l'ÃĒge de bronze pour marquer les saisons claires et sombres ? De mÊme certains sanctuaires plus fÃĐminins comme ceux dÃĐdiÃĐs aux grandes sources pouvaient Être orientÃĐs sur une astrologie lunaire. Ce n'est pas pour rien par exemple à Stonehenge que les astronomes ont calculÃĐ dÃĻs l'ÃĒge de bronze leur cycle de MÃĐton à eux. Je pense d'ailleurs que si, par la "celtisation" de la culture l'annÃĐe solaire est devenue civile, l'annÃĐe religieuse ÃĐtait lunaire. Ce n'est pas une critique, entend le bien, mais une interrogation. Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modÃĻle la terre, la pensÃĐe modÃĻle le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Pfiou... Et moi qui croyait que renards, loups et autres canidÃĐs devaient leur caractÃĻre "chtonien" à leur museau enfoui en permanence dans la terre... Je les retrouve la tÊte dans les ÃĐtoiles ! De la constellation du chien à l'annÃĐe du mÊme nom, je perçois là l'influence pernicieuse d'un azimut propice aux dÃĐrives thÃĐmatiques...
Site Internet : http://luern.free.fr
Pourquoi chtonien ? Du domaine sauvage extÃĐrieur aux territoires "humanisÃĐs", cultivÃĐs par exemple... Je ne suis pas sÃŧr que le "monde chtonien" auquels les gaulois faisaient des sacrifices dans les fosses, sans partage, corresponde au "domaine sauvage" suivant la dÃĐfinition qu'en donne Guilaine par exemple.
Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modÃĻle la terre, la pensÃĐe modÃĻle le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Chienne de vie !
Le chien est, dans le monde celtique, lâobjet de comparaisons guerriÃĻres ou de mÃĐtaphores flatteuses, mais aussi un compagnon bon à manger pour les Celtes continentaux ou au contraire un interdit alimentaire pour les Celtes dâIrlande. Les Grecs au contraire mettront en ÃĐpitaphe les particularitÃĐs dÃĐplaisantes du chien, entre autre son aviditÃĐ, sa servilitÃĐ et son absence de pudeur, qui ÃĐtaient proverbiales. Pour les Romains, les chiens jouaient un rÃīle protecteur important âĶ Les pittoresques anecdotes canines dans le monde antique :
MANLIUS CAPITOLINUS Manlius, surnommÃĐ "Capitolinus" en raison de la dÃĐfense du Capitole, et de lâalerte donnÃĐe par les oies, car les chiens dormaient : http://perso.wanadoo.fr/textes.histoire ... RR_206.htm A l'inverse, toujours chez les Romains, on retrouvera pourtant le chien comme symbole protecteur et de la vigilance ou lares praestites :
e.
Notez que le "Irish Wolfhound" des textes anglais est la plupart du temps improprement traduit par "chien-loup"....
C'est un chien A loups, plus exactement un louvetier... _______________________________________
Gwalchafed
Charente
SÃĐpulture d'un chien de l'ÃĒge du fer PrÃĻs d'AngoulÊme, une fouille prÃĐventive a mis au jour des enclos funÃĐraires du VIe-Ve siÃĻcle avant J.-C. Dans l'un deux, le squelette d'un chien reposait au fond d'un puits : sÃĐpulture d'un compagnon ou offrande d'un gardien pour l'ÃĐternitÃĐ ?
e.
Salut,
Ejds, merci beaucoup pour cette info, je transmets... J'en connais un qui va Être trÃĻs content ! Jean-Paul Brethenoux. Sedullos Lemouico immi exobnos in catue ! ÎĢÎÎÎÎĨÎÎÎÎĢ (Graecum est, non legitur !)
"Honorer les dieux, ne pas faire le mal, s'exercer à la bravoure."
52 messages • Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Histoire / ArchÃĐologie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrÃĐ et 31 invitÃĐs
Accueil |
Forum |
Livre d'or |
Infos Lègales |
Contact
Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |