Comment donc de l'Aluminium alors que ce mﺣ۸tal ne rﺣ۸apparait qu'a la fin du 19 siﺣ۸cle en EUROPE
En fait au XIXﺣ۷me, ce qui est dﺣ۸couvert, c'est la mﺣ۸thode de sﺣ۸paration de l'aluminium. Il ﺣ۸tait connu bien avant, mais pas moyen de l'isoler.
@+Pierre
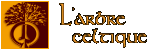


 :51:
:51: