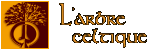|
Les Rois du MondeModﺣ۸rateurs: Pierre, Guillaume, Patrice Merci Thierry pour ces ﺣ۸lﺣ۸ments trﺣ۷s intﺣ۸ressants sur Bourges, qui est trﺣ۷s prﺣ۷s de chez moi. Il va falloir que je me procure ce numﺣ۸ro des Dossiers de l'Archﺣ۸ologie. Est-il dﺣ۸jﺣ sorti ?
Fergus
-------------- - Ceist, a gillai forcetail, cia doaisiu mac ? - Ni ansa : macsa Dana, Dﺣ n mac Osmenta, (...) Ergna mac Ecnai, Ecna mac na tri nDea nDﺣ na Extrait du Dialogue des Deux Sages
Pierre Crombet
Fourberie en tout genre ... stock illimitﺣ۸  (outrecuidance sur commande uniquement) Membre du Front de Libﺣ۸ration des Dolmens et Menhirs....
Re: Les Rois du Mondehello Pierre,
Mes connaissances halstattiennes se limitent ﺣ Vix, Hotchdorf et une certaine mine de sel.... Tout ce que j'avais lu ﺣ ce sujet ne parlait que de petites communautﺣ۸s et de princes trﺣ۷s riches. Rien n'y faisait penser ﺣ une civilisation urbaine ou proto-urbaine (j'ignore d'ailleurs la diffﺣ۸rence entre les deux) Jusqu'ﺣ ce que je tombe il y a quelques mois sur un fil dans l'AC sur des constructions dans les parages de Vix. Bref, c'est quoi La Heunebourg? Un site, une sous-pﺣ۸riode de Halstatt? (et j'ai dﺣ۸jﺣ cherchﺣ۸ dans la recherche rapide)
Je peux jouer aussi? Je propose : une diminution drastique et soudaine de la population (ﺣ۸pidﺣ۸mie) qui traumatise les survivants au point de remettre en question des points cruciaux de leur civilisation? "We fear you not"
Bonjour Thangorofrim,
La Heuneburg est un habitat fortifiﺣ۸ (en partie fortifiﺣ۸ serait plus juste) des VIﺣ۷me et Vﺣ۷me siﺣ۷cles avant J.-C. prﺣ۷s des sources du Danube (en Autriche). On y a retrouvﺣ۸ un habitat structurﺣ۸ sur une surface de plus de 20Ha, et chose trﺣ۷s remarquable et unique dans le monde celtique, le rempart est en briques de terre crue, ﺣ l'instar de ses homologues grecs (solution qui d'ailleurs s'est avﺣ۸rﺣ۸e complﺣ۸tement inadaptﺣ۸e pour ce climat). Certains ont ﺣ۸tﺣ۸ jusqu'ﺣ supposer que la fameuse ville de "Pyrﺣ۷ne" citﺣ۸e par Hﺣ۸rodote, pourrait-etre la Heuneburg... http://www.dhm.de/museen/heuneburg/indexf.html http://www.dhm.de/museen/heuneburg/fr/einfuehrung2.html @+Pierre Pierre Crombet
Fourberie en tout genre ... stock illimitﺣ۸  (outrecuidance sur commande uniquement) Membre du Front de Libﺣ۸ration des Dolmens et Menhirs....
Bonjour Fergus Il s'agit du nﺡﺍ356 - Les Dossiers d'archﺣ۸ologie - Les Celtes et la Loire, sorti en Mars - Avril, cette annﺣ۸e. Visiblement il y a une exposition organisﺣ۸e ﺣ Bourges. Oﺣﺗ et quand ?
Et pendant ce temps lﺣ , en Bourgogne, une autre ville, et un bﺣ۱timent gﺣ۸ant dotﺣ۸ d'une abside
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1160.htm Pendant un moment, les archﺣ۸ologues ont cru s'ﺣ۹tre trompﺣ۸ de plus d'un millﺣ۸naire Oﺣﺗ et quand ?
Et voici le dossier de presse de l'exposition de Bourges
http://www.musees.regioncentre.fr/UploadFile/GED/Actualite/PJKS-Dossier_presse.pdf Oﺣﺗ et quand ?
Re: Les Rois du Monde
Il y aurait plutﺣﺑt une dﺣ۸mographie galopante ﺣ cette ﺣ۸poque d'oﺣﺗ recherche de nouvelles terres avec son corolaire, le dﺣ۸veloppement exponentiel de l'idﺣ۸ologie guerriﺣ۷re, c'est suffisant. Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Re: Les Rois du Monde
Oui, c'est vrai, Sﺣ۸govﺣ۷se et Bellovﺣ۷se.... "Jusqu'ﺣ prﺣ۸sent, on pensait que l'urbanisation de l'Europe occidentale n'avait commencﺣ۸ qu'avec la civilisation des oppida (IIe - Ier siﺣ۷cle avant notre ﺣ۷re). Mais depuis quelques annﺣ۸es, les fouilles d'autres sites contemporains de Vix avaient dﺣ۸jﺣ fourni quelques indices en faveur d'un dﺣ۸veloppement urbain prﺣ۸coce (ﺣ La Heuneburg et Ipf, en Allemagne, ou ﺣ Bourges, en France). Ces dﺣ۸couvertes, confirmﺣ۸es par les trouvailles de Vix, font donc reculer l'apparition des premiﺣ۷res villes de plusieurs siﺣ۷cles dans cette rﺣ۸gion." C'est trﺣ۷s exaltant d'apprendre des choses comme ca : 3 ﺣ 5 siﺣ۷cles d'urbanisation en plus! C'est un bond ﺣ۸norme dans le temps, il me semble. Et trﺣ۷s triste de se dire que finalement monsieur et madame Toutlemonde n'en saura rien car finalement le monde celtique continue de peu interresser les mﺣ۸dias. Le Francais moyen continue de croire que les Romains ont apportﺣ۸ les villes et les routes dans leurs bagages et que les Gaulois n'ﺣ۸taient que de grossiers guerriers incultes et indisciplinﺣ۸s qui devraient dire "merci de nous civiliser" ﺣ leurs bouchers. La preuve, le roman que je suis en train de lire oﺣﺗ les Gaulois - mauvais cavaliers, mal chaussﺣ۸s, mal vﺣ۹tus, armﺣ۸s ﺣ۸videmment de haches et de casques ﺣ cornes - font pitiﺣ۸ ﺣ voir : des vrais sauvages. Il ne leur manque que les peaux de bﺣ۹te et le tableau est complet! Alors, aprﺣ۷s des trucs comme ca, ca fait plaisir de lire que ces sauvages batissaient des villes et des palais. Na! "We fear you not"
Et nous ne sommes pas au bout des surprises......
En tout cas il est fondamentalement passionnant de rﺣ۸aliser que les Celtes de Vix construisaient des bﺣ۱timents complexes dont on ne retrouvera l'ﺣ۸quivalent qu'en pﺣ۸riode byzantine ou carolingienne et que la ville de Bourges ﺣ۸tait bien plus importante que Rome au Vﺡﺍ siﺣ۷cle AV JC Oﺣﺗ et quand ?
Bonjour ﺣ tous,
Un petit message de la part de Mr P.-Y. Milcent. Qui m'autorise ﺣ vous communiquer le rﺣ۸sumﺣ۸ de son ouvrage. Et j'en profite pour lui adresser tous mes remerciements.
Pierre Crombet
Fourberie en tout genre ... stock illimitﺣ۸  (outrecuidance sur commande uniquement) Membre du Front de Libﺣ۸ration des Dolmens et Menhirs....
Trﺣ۷s intﺣ۸ressant, merci
Un petit point : Le dﺣ۸veloppement du village ﺣ la ville dﺣ۸pend surtout des surplus agricoles. Nous savons que cette ﺣ۸volution a ﺣ۸tﺣ۸ permise au Moyen-Orient par "l'invention" de l'irrigation et je pense qu'il a du aussi se passer quelque chose en Europe durant le Hallstatt. Inventions amﺣ۸liorant le rendement des terres ou nouveaux produits plus performants ? Lﺣ est la question Sinon le livre de P.-Y. Milcent me semble fort intﺣ۸ressant, ﺣ suivre donc Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Bonjour,
Pour les visuels (comme moi) quelques images de la situation hydrologique de Bourges dont une interprﺣ۸tation de la carte de Cassini (18ﺡﺍ S). http://www.cher.pref.gouv.fr/atlas-cher ... es/B71.pdf Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a beaucoup d'eau avec des riviﺣ۷res au dﺣ۸bit relativement stable mﺣ۹me l'ﺣ۸tﺣ۸ et des crues modﺣ۸rﺣ۸es. Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Encore moi ﺣ dﺣ۸faut d'autres commentateurs
En ﺣ۸tudiant les donnﺣ۸es du terrain ici et lﺣ sur le web et ailleurs, il me semble qu'il y a plusieurs pﺣﺑles d'habitat (en terrain sec) mﺣ۹me si le coeur est sur la "hauteur" au confluent des riviﺣ۷res principales. Peut-on imaginer une citﺣ۸e multipolaire comme Matthieu l'a signalﺣ۸ pour Corent ? Muskull / Thomas Colin
Comme l'eau modﺣ۷le la terre, la pensﺣ۸e modﺣ۷le le possible. http://muskull.arbre-celtique.com/ http://thomascolin.fr
Retourner vers Histoire / Archﺣ۸ologie Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrﺣ۸ et 33 invitﺣ۸s
Accueil |
Forum |
Livre d'or |
Infos Lègales |
Contact
Conception : Guillaume Roussel - Copyright © 1999/2009 - Tous droits rèservès - Dèpôts INPI / IDDN / CNIL(1006349) / SCAM(2006020105) | |