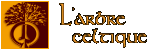http://magister.olympe-network.com/foru ... f=39&t=242
LES UNITES "BRETONNES" DANS LA NOTITIA DIGNITATUM
Avant-propos
Les noms ethniques de la Notitia Dignitatum (document de la fin du IVe siﺣ۷cle/dﺣ۸but du Ve) permettent d'identifier une partie des unitﺣ۸s comme ﺣ۸tant d'origine bretonne ou gaﺣ۸lique, il en reste que pour beaucoup d'autres nous n'avons pas d'idﺣ۸e du recrutement d'origine.
La synthﺣ۷se qui suit a pour but de rﺣ۸pertorier ces diffﺣ۸rentes unitﺣ۸s, celles explicitement bretonnes, mais aussi d'autres qui ont pu ﺣ۹tre composﺣ۸es de Bretons.
Les Bretons des franges occidentales de l'ﺣ؟le, les plus faiblement romanisﺣ۸s, constituaient probablement d'excellentes recrues, fiﺣ۷res de leur appartenance ﺣ l'empire mais toujours forts de leur vertu guerriﺣ۷re. Rome tolﺣ۸ra d'ailleurs - les encourageant mﺣ۹me peut ﺣ۹tre - les royautﺣ۸s locales du futur Pays de Galles ou des Dumnonii ﺣ rester armﺣ۸es pour assurer leurs dﺣ۸fenses contre les barbares irlandais.
Immﺣ۸diatement au nord du mur d'Hadrien, on trouvait plusieurs tribus bretonnes alliﺣ۸es ﺣ l'empire. Si la rﺣ۸gion entre les murs d'Hadrien et d'Antonin n'ﺣ۸tait officiellement plus sous contrﺣﺑle romain, les territoires des Damnonii, Selgovae, Votadini et autres ﺣ۸taient probablement ﺣ certaines ﺣ۸poques des royaumes clients de Rome, ﺣ۸tats tampons contre les incursions des Pictes. L'ﺣ۸tat major romain pouvait y recruter ses exploratores ou ﺣ۸claireurs.
Enfin, de nombreux Gaﺣ۸ls s'installﺣ۷rent dans l'antiquitﺣ۸ tardive en Britannia. S'ils ﺣ۸taient souvent hostiles, certaines de leurs dynasties comme celle des rois du Dyfed devinrent des alliﺣ۸s de Rome.
A ces recrues potentielles, on doit ajouter les citoyens de la Bretagne romaine, bien sur eux aussi susceptibles d'ﺣ۹tre enrﺣﺑlﺣ۸s.
I - Les troupes bretonnes dans le diocﺣ۷se des Bretagnes
Une bonne partie des troupes stationnﺣ۸es en Bretagne insulaire, mﺣ۹me si provenant d'autres rﺣ۸gions de l'empire, ont du voir leurs rangs composﺣ۸s de Bretons ﺣ un moment ou ﺣ un autre de leur histoire. Ces troupes furent successivement retirﺣ۸es de l'ﺣ؟le par Maximus Magnus, Stilicho et Constantin III, mﺣ۹me si une petite partie d'entre elles restﺣ۷rent peut-ﺣ۹tre en arriﺣ۷re aprﺣ۷s 407. La Notitia Dignitatum, nous donne l'ﺣ۸tat de ces forces vers 400, soit aprﺣ۷s l'usurpation de Maxime et avant celle de Constantin III, et probablement avant que Stilicho ramﺣ۷ne plusieurs de ces lﺣ۸gions sur le continent, mais les difficultﺣ۸s du document ne permettant pas de dﺣ۸terminer lesquelles avec prﺣ۸cision.
On trouve trois commandements en Britannia, ﺣ savoir deux comtes et un duc.
A noter qu'on connaﺣ؟t mal les troupes assignﺣ۸es ﺣ la dﺣ۸fense du littoral occidental, et leur commandement, mﺣ۹me si les fortifications (comme Caerwent ou Caernarfon) sont bien existantes.
1) Comes Britanniarum
Le Comes Britanniarum commandait aux Comitatenses, l'armﺣ۸e mobile.
Pour mﺣ۸moire, on retrouve sous ses ordres :
Victores iuniores Britanniciani
Primani iuniores
Secundani iuniores
Equites catafractarii iuniores
Equites scutarii Aureliaci
Equites Honoriani seniores
Equites stablesiani
Equites Syri
Equites Taifali
Au moins deux de ces unitﺣ۸s peuvent ﺣ۹tre identifiﺣ۸s comme ﺣ recrutement breton :
Victores iuniores Britanniciani
Parfois identifiﺣ۸s comme les Victores iuniores que l'on retrouve en Espagne.

Secundani iuniores
L'hypothﺣ۷se la plus populaire voudrait qu'il s'agisse de la Secunda Britannica que l'on retrouve sous les ordres du Magister equitum per Gallias.
On en reparlera plus loin.
2) Comes litoris Saxonici per Britanniam
Un autre comte (?) avait la charge des troupes stationnﺣ۸es dans la sﺣ۸rie de forts assurant la dﺣ۸fense du litus saxonicum.
On retrouve sous son commandement des troupes de limitanei :
Praepositus numeri Fortensium
Praepositus militum Tungrecanorum
Praepositus numeri Turnacensium
Praepositus equitum Dalmatarum Branodunensium
Praepositus equitum stablesianorum Gariannonensium
Tribunus cohortis primae Baetasiorum
Praefectus legionis secundae Augustae
Praepositus numeri Abulcorum
Praepositus numeri exploratorum
Certaines de ses unitﺣ۸s sont peut ﺣ۹tre les mﺣ۹mes que mentionnﺣ۸s sous le commandement du Comes Britanniarum, ﺣ savoir la Secunda Augusta stationnﺣ۸e ﺣ Rutupiae/Richborough dans le Kent. Elle est connue dﺣ۷s le haut empire comme Legio II Augusta Britannica et aurait donnﺣ۸ naissance ﺣ plusieurs unitﺣ۸s au bas empire.
Les exploratores en qualitﺣ۸ d'ﺣ۸claireurs seraient plutﺣﺑt des indigﺣ۷nes.
Les Abulci stationnﺣ۸s ﺣ Anderita/Pevensey portent un nom d'origine brittonique, dﺣ۸rivﺣ۸ de *bulc, brﺣ۷che, ou entaille, que l'on retrouve d'ailleurs dans le nom de l'ﺣ۸pﺣ۸e mythique d'Arthur, Caledfwlch en Gallois, "dure entaille". On les retrouve aussi sur le continent, Anderita ﺣ۸tant probablement leur centre de recrutement.
3) Dux Britanniarum
Le dux commandait aux unitﺣ۸s limitanei stationnﺣ۸es dans le nord de la Bretagne, notamment sur le mur d'Hadrien. Certaines unitﺣ۸s sont lﺣ encore peut ﺣ۹tre les mﺣ۹mes que d'autres sous les ordres des deux comes, ce n'est pas clair.
Les prﺣ۸fectures :
Praefectus legionis sextae
Praefectus equitum Dalmatarum
Praefectus equitum Crispianorum
Praefectus equitum catafractariorum
Praefectus numeri barcariorum Tigrisiensium
Praefectus numeri Nerviorum Dictensium
Praefectus numeri vigilum
Praefectus numeri exploratorum
Praefectus numeri directorum
Praefectus numeri defensorum
Praefectus numeri Solensium
Praefectus numeri Pacensium
Praefectus numeri Longovicanorum
Praefectus numeri supervenientium Petueriensium
Les tribuns et prﺣ۸fets du mur :
Tribunus cohortis quartae Lingonum
Tribunus cohortis primae Cornoviorum
Praefectus alae primae Asturum
Tribunus cohortis primae Frixagorum
Praefectus alae Sabinianae
Praefectus alae secundae Asturum
Tribunus cohortis primae Batavorum
Tribunus cohortis primae Tungrorum
Tribunus cohortis quartae Gallorum
Tribunus cohortis primae Asturum
Tribunus cohortis secundae Dalmatarum
Tribunus cohortis primae Aeliae Dacorum
Praefectus alae Petrianae
Praefectus numeri Maurorum Aurelianorum
Tribunus cohortis secundae Lingonum
Tribunus cohortis primae Hispanorum
Tribunus cohortis secundae Thracum
Tribunus cohortis primae Aeliae classicae
Tribunus cohortis primae Morinorum
Tribunus cohortis tertiae Nerviorum
Cuneus Sarmatarum (no officer listed)
Praefectus alae primae Herculeae
Tribunus cohortis sextae Nerviorum
Les exploratores, directores, vigiles sont des unitﺣ۸s d'ﺣ۸claireurs, et donc trﺣ۷s probablement ﺣ recrutement indigﺣ۷ne : peut-ﺣ۹tre des hommes provenant des tribus bretonnes alliﺣ۸es ﺣ Rome comme les Votadini.
Les Superventores Petuarienses proviennent du fort de Petuaria, dﺣ۸fendant l'estuaire de l'Humber. Il s'agﺣ؟t peut-ﺣ۹tre de troupes de marine chargﺣ۸s de repousser les raids des pirates pictes et germaniques et de surveiller la cﺣﺑte du Yorkshire actuel.
La Cohors Prima Cornoviorum ﺣ۸tait recrutﺣ۸e chez les Cornovii de la rﺣ۸gion de Wroxeter/Viroconium, centre de pouvoir d'ailleurs trﺣ۷s important ﺣ la pﺣ۸riode sub-romaine, capitale du royaume du Powys ou de Pengwern.
II - Les troupes bretonnes sur le continent
Des unitﺣ۸s ﺣ recrutement insulaire ﺣ۸taient naturellement affectﺣ۸es ailleurs dans l'empire, et suite ﺣ l'usurpation de Maxime les soldats qui dﺣ۸barquﺣ۷rent avec lui en 383 ne revinrent jamais dans l'ﺣ؟le. Des problﺣ۷mes dans les rﺣ۸visions de la Notitia font qu'on rencontre certaines unitﺣ۸s ﺣ la fois en Bretagne et sur le continent.
1) Dux tractus Armoricani et Nervicani
La tradition veut que les Bretons de l'armﺣ۸e de Maxime furent installﺣ۸s dans le nord de la Gaule. Ils y auraient renforcﺣ۸ le dispositif de dﺣ۸fense du tractus armoricanus. Cependant, mis ﺣ part peut-ﺣ۹tre les Superventores de Nantes si l'on les considﺣ۷re comme liﺣ۸s aux Superventores Petuarienses que l'on a rencontrﺣ۸ en Bretagne, aucune des unitﺣ۸s ne peut ﺣ۹tre dﺣ۸terminﺣ۸e comme bretonne. Certes, il est fort possible que des Bretons aient ﺣ۸tﺣ۸ recrutﺣ۸s par la suite au sein de ces unitﺣ۸s aprﺣ۷s leur installation en Armorique. Les unitﺣ۸s armoricaines, des limitanei en charge de la dﺣ۸fense des cﺣﺑtes gauloises contre les pirates germaniques et irlandais, semblent avoir ﺣ۸tﺣ۸ retirﺣ۸es de leurs garnisons et promues au statut de pseudocomitatenses, rejoignant l'armﺣ۸e de manﺧuvre. On peut supposer que des Bretons reprirent leurs postes, comme l'indique l'occupation continue de forts du tractus comme Alet ou le Coz-Yaudet, du IVe au VIe siﺣ۷cle.
On retrouve aussi des colonies ﺣ l'intﺣ۸rieur des terres attribuables ﺣ des lﺣ۷tes germaniques mais aussi probablement aux Bretons pour la civitas des Ossismes, dﺣ۷s la fin du IIIe siﺣ۷cle. Ces ﺣ۸tablissements ne sont pas rﺣ۸pertories dans la Notitia Dignitatum. Ils permettaient probablement de complﺣ۸ter le systﺣ۷me de dﺣ۸fense du tractus armoricanus, et de rﺣ۸serves de recrutement.
On citera pour mﺣ۸moire les troupes du dux du tractus armoricain :
Tribunus cohortis primae novae Armoricanae
Praefectus militum Carronensium
Praefectus militum Maurorum Benetorum
Praefectus militum Maurorum Osismiacorum
Praefectus militum superventorum
Praefectus militum Martensium
Praefectus militum primae Flaviae
Praefectus militum Ursariensium
Praefectus militum Dalmatarum
Praefectus militum Grannonensium
2) Magister equitum per Gallias
Comme ﺣ۸voquﺣ۸ prﺣ۸cﺣ۸demment on retrouve sous ses ordres les unitﺣ۸s du tractus armoricanus. Il commande ﺣ des unitﺣ۸s de cavalerie et d'infanterie.
Voici les troupes identifiables comme bretonnes.

Britones - Auxilia Palatina
Le nom ethnique est ﺣ۸vident.

Atecotti Honoriani seniores - Auxilia Palatina
Les Atecotti ne sont pas "bretons" ﺣ proprement parler, mais probablement irlandais. Lﺣ۸on Fleuriot les faisait venir du nord de la Bretagne, et explique leur nom par un celtique *Ate (prﺣ۸fixe d'intensitﺣ۸) et *Cot, en breton coz, dans le sens de "vieux", "ancien" ; ce qui donne les "trﺣ۷s anciens".
Les thﺣ۸ories plus rﺣ۸centes en font des Irlandais, et explique leur nom par une latinisation d'un gaﺣ۸lique Aitheachtuatha, "tribu payant tribut". Le sens de ce terme est proche de celui de Deisi, "vassaux", qui dﺣ۸signent des tribus soumises et considﺣ۸rﺣ۸es comme infﺣ۸rieures par les autres Gaﺣ۸ls. Des Deisi, expulsﺣ۸s d'Irlande, s'installﺣ۷rent ainsi dans le sud du Pays de Galles et s'alliﺣ۷rent par la suite aux Romains de Maximus Magnus.
C'est probablement un phﺣ۸nomﺣ۷ne similaire qui poussa les Atecotti ﺣ la piraterie, chassﺣ۸s suite aux ﺣ۸vﺣ۸nements politiques irlandais. On les retrouve impliquﺣ۸s dans la sﺣ۸rie d'attaques contre la Bretagne, aux cﺣﺑtﺣ۸s des Pictes et des autres Scotti.
Il s'agit donc plutﺣﺑt d'un terme gﺣ۸nﺣ۸rique dﺣ۸signant un certain type de tribu plutﺣﺑt qu'une tribu en particulier, et certains d'entre eux ﺣ۸taient peut-ﺣ۹tre installﺣ۸s en Britannia, dont les Deisi du Dyfed.
Il peut s'agir de prisonniers de guerre ou deditices, mais aussi de barbares ayant cherchﺣ۸ emploi auprﺣ۷s de Rome. La tradition irlandaise parle ainsi de l'une des versions de la mort du haut-roi Niall Noigiallach, tuﺣ۸ dans les Alpes en combattant pour les Romains, aprﺣ۷s avoir passﺣ۸ de longues annﺣ۸es ﺣ se battre contre eux en Britannia.
On retrouve des Scotti, ou Irlandais, dans les ﺣ۸crits de Saint-Jﺣ۸rﺣﺑme qui les aurait rencontrﺣ۸ aux abords de Trﺣ۷ves, au IVe siﺣ۷cle, et leur prﺣ۹te une rﺣ۸putation de sauvagerie et mﺣ۹me de cannibalisme. Il s'agit peut ﺣ۹tre d'une des unitﺣ۸s d'Atecotti :
Que vous dirai-je des autres nations, puisque moi-mﺣ۹me, ﺣ۸tant encore jeune, jﻗai vu des Scotti dans la Gaule, qui, pouvant se nourrir de porcs et dﻗautres animaux dans les forﺣ۹ts, aimaient mieux couper les fesses des jeunes garﺣ۶ons, et les tﺣ۸tons des jeunes filles! Cﻗﺣ۸taient pour eux les mets les plus friands.
Saint-Jﺣ۸rﺣﺑme, Lettres.

Atecotti iuniores Gallicani - Auxilia Palatina
Ces Atecotti sont dits Gallicani, peut-ﺣ۹tre parce que issus d'une communautﺣ۸ installﺣ۸e en Gaule ?

Secundani Britones ou Secunda Britannica - Legio Comitatenses
Dﺣ۸taillons maintenant un peu l'historique de la Secunda Britannica que nous avons dﺣ۸jﺣ rencontrﺣ۸ en Bretagne. Elle semble issue de la fragmentation de la Legio II Augusta Britannica que l'on retrouve ﺣ Brittenheim ou Bretzenheim, villa Britannica prﺣ۷s de Mayence au haut empire.
Elle ﺣ۸tait notamment basﺣ۸e ﺣ Rutupis (Richborough) sur le litus saxonicum, et il est intﺣ۸ressant de noter que l'usurpateur Maxime est qualifiﺣ۸ par Orose de Rutupinus latro.
A noter que la vie de saint Dalmas mentionne une Legio Britannica vers 533 dans la rﺣ۸gion d'Orlﺣ۸ans, peut ﺣ۹tre une survivance de cette unitﺣ۸ d'aprﺣ۷s Lﺣ۸on Fleuriot.

Praesidienses - Legio Comitatenses
Unitﺣ۸ probablement nommﺣ۸e d'aprﺣ۷s le fort de Praesidium dans le nord de la Bretagne insulaire, passﺣ۸e sur le continent avec Maxime ou Stilicho.
Anderetiani - Legio Pseudocomitatenses
Leur nom ﺣ۸voque irrﺣ۸sistiblement celui du fort d'Anderita/Pevensey sur littoral saxon, peut ﺣ۹tre y ﺣ۸tait ils recrutﺣ۸s ﺣ l'instar des Abulci, mais il peut aussi ﺣ۹tre expliquﺣ۸ selon Lﺣ۸on Fleuriot par un prﺣ۸fixe intensif *ante- et un radical *ret, "course", ce seraient donc les "super-coureurs".
Ils auraient servi le Dux Mogontiacensis (en Germanie) avant de rejoindre l'armﺣ۸e de campagne.
On retrouve ﺣ۸galement une classis Anderetianorum sur la Seine, et on connaﺣ؟t entre autres par Vﺣ۸gﺣ۷ce la valeur des marins bretons dans la flotte romaine.
Abulci - Legio Pseudocomitatenses
On a dﺣ۸jﺣ rencontrﺣ۸ le numerus Abulcorum ﺣ Anderita/Pevensey sur le litus saxonicum et leur centre de recrutement, et par ailleurs expliquﺣ۸ leur nom, bien brittonique.
A noter que les Exploratores et les Defensores seniores sont aussi pour certains des troupes venus de Bretagne (entre autres).
3) Comes Hispenias
Des diffﺣ۸rentes unitﺣ۸s sous les ordres du Magister Peditum, on retrouve sous le commandement du comes Hispenias :

Invicti iuniores Britones - Auxilia Palatina

Exculcatores iuniores Britanniciani - Auxilia Palatina
Ces derniers sont mentionnﺣ۸s seulement comme Exculcatores iuniores pour l'Ibﺣ۸rie mais on peut penser qu'il s'agit de la mﺣ۹me unitﺣ۸.
4) Comes Illyricum & Magister Militum per Illyricum
L'Illyrie vu en 388 la dﺣ۸faite de Maximus Magnus contre Thﺣ۸odose, empereur d'Orient, et certaines des troupes de l'usurpateur semblent avoir ﺣ۸tﺣ۸ affectﺣ۸es dans la province dﺣ۷s lors.

Seguntienses - Auxilia Palatina
Cette unitﺣ۸ formait vraisemblablement le fer de lance de l'armﺣ۸e de Maxime. Ils venaient sans doute du fort de Segontium, actuellement Caernarvon dans le nord du Pays de Galles. La tradition brittonique fait partir l'armﺣ۸e de Maxime, ou plutﺣﺑt Macsen Wledig tel qu'il est dﺣ۸signﺣ۸ chez les Gallois, de cette rﺣ۸gion.

Latini - Auxilia Palatina
Soazick Kerneis ﺣ۸voque ﺣ leur sujet une possible corruption du nom des Liathain, Deisi irlandais installﺣ۸s dans le Dyfed et alliﺣ۸s de Maxime. Il s'agﺣ؟t donc peut-ﺣ۹tre d'insulaires, aucune certitude ﺣ leur sujet.
Sous les ordres du Magister Militum per Illyricum dans la Pars Orientem on retrouve :

Britones seniores - Legio Palatina
Leur nom mentionne explicitement leur origine.

Atecotti - Auxilia Palatina
Leur nom et origine ont ﺣ۸tﺣ۸ explicitﺣ۸s ci-dessus.
4) Magister Peditum per Italia
On retrouve en Italie :

Atecotti Honoriani iuniores - Auxilia Palatina
Leur nom et origine a ﺣ۸tﺣ۸ expliquﺣ۸e prﺣ۸cﺣ۸demment.

Sabini - Auxilia Palatina
Selon Soazick Kerneis, peut ﺣ۹tre une corruption d'un original Sabrini, dﺣ۸signant des Bretons du bord de la Severn.
III - Les Bretons dans la Pars Orientem
On retrouve plusieurs unitﺣ۸s bretonnes en Orient. Il est possible que certaines d'entre elles soient d'anciennes troupes de Maxime, envoyﺣ۸es au loin suite ﺣ leur soutien envers l'usurpateur.
Ala quarta Britonum
Mentionnﺣ۸s sous le commandement du Dux Thebaidos en Egypte.
Les unitﺣ۸s stationnﺣ۸es en Illyrie ont dﺣ۸jﺣ ﺣ۸tﺣ۸ mentionnﺣ۸es.
SOURCES :
http://www.ne.jp/asahi/luke/ueda-sarson ... terns.html
Les Origines de la Bretagne, Lﺣ۸on Fleuriot.
Les Celtiques: servitude et grandeur des auxiliaires bretons sous l'Empire Romain, Soazick Kerneis (voir la fiche de lecture : http://magister.olympe-network.com/foru ... f=39&t=167)
Benjamin Franckaert